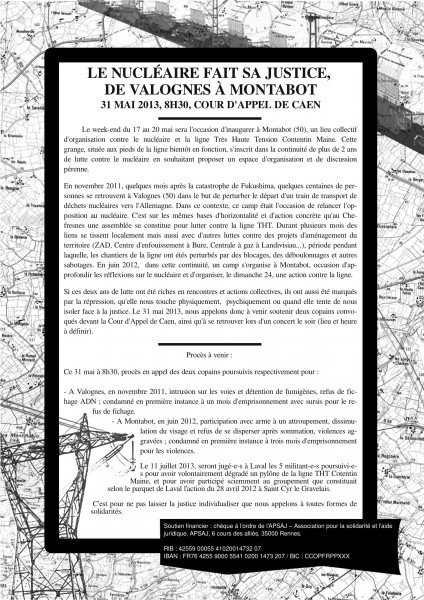Retour sur l’audience du 23 janvier 2014 à Laval
vendredi, janvier 31st, 20143 personnes étaient convoquées ce jeudi 23 janvier 2014 au tribunal de Laval pour avoir, dans le cadre d’une enquête ouverte pour des faits de « dégradations… et participation à un attroupement formé en vue de la préparation des dites dégradations », refusé de se soumettre aux relévés d’empreintes, photos et prélèvement ADN..
RTE s’était déjà adjoint les services de l’état par le biais de ses préfectures, de ses gendarmes, afin de violer nos terres pour y installer ses pylones. Aujourd’hui, c’est le parquet de Laval qui se met au service de RTE pour tenter, sous la menace d’un an emprisonnement et de 15000€ d’amende, de violer notre intégrité physique, en voulant nous soumettre à ce prélèvement ADN.
L’avocat de la défense ouvre le bal en plaidant la nullité de la procédure, des pièces manquent au dossier : les PV de demandes de prélèvement, et ceux actant le refus !! Deux PV sont bien arrivés par fax , la veille, au cabinet de l’avocat…
Manque de bol, par précipitation sans doute, le parquet s’est trompé d’intitulé : le texte de loi auquel il fait référence parle de refus dans le cadre d’une vérification d’identité, or les 3 sont convoquées dans un autre cadre (voir plus haut)…
En clair, dans le langage des « gens de droit », le procureur (celui qui poursuit), dans son empressement à taper sur la goule des opposants à la THT, s’est loupé et est invité à revoir sa copie. Y’aurait un problème de vocabulaire qui dirait qu’on s’est peut-être déplacés pour rien…
Le président du tribunal est ensuite pris à témoin, « vous avez eu accès au dossier d’accusation en ce qui concerne les faits de dégradation, vous ne pouvez que constater que rien ne permet de prouver que les prévenus se soient rendus coupables des dites dégradations. En clair : le dossier est vide. »
« Nous sommes là pour juger les refus de prélèvement, pas le fond du dossier… »
« Vous rendez les jugements « au nom du peuple français », le peuple a le droit de savoir ! »
Sur la centaine de personnes, dont quelques élus, qui s’était déplacée à Montaudin pour un déboulonnage symbolique d’un pylone en construction au printemps 2012, seules 3 personnes sont à la barre. Ces personnes auraient-elles été choisies par
hasard ? Chose troublante, 2 des 3 personnes convoquées ont déposé une plainte contre RTE, la préfète de la Mayenne et les gendarmes… Plainte classée sans suite par le procureur de Laval : celui-là même qui rappelle que la loi est la même pour
tout le monde !?!
Que le « peuple français » se rassure, la plainte est en ce moment instruite par un juge d’instruction.
Puis vient le tour du dernier prévenu, cerise sur le gâteau. « Je me demande ce que je fais là. Le jour des faits, je n’étais pas présent à Montaudin, je n’apparais sur aucune des photos prises sur place (40 000 nous a-t-on dit !!!). L’embarras se lit sur le visage de la procureure… et sur celui du juge.
S’il fallait encore démontrer que les poursuites avaient pour seul objet la condamnation de militants pour leurs opinions, preuve en était faite.
La procureure, qui s’était montrée plutôt agressive dans les affaires précédentes, requiert une peine d’amende (sans en préciser le montant) et ne s’oppose pas au sursis !! Se dégonflerait-elle ?
L’avocat des trois militants a quant à lui plaider ce qui lui semble la
seule issue possible à ce procès : la relaxe.
Décision mise en délibéré au 20 février à 14h.
Fond de soutien pour les frais de justice :
Chèque à l’ordre de l’APSAJ – Association pour la solidarité et l’aide juridique,
APSAJ, 6, cours des alliés, 35000 Rennes
RIB : 42559 00055 41020014732 07
IBAN : FR76 4255 9000 5541 02001473 207/BIC : CCOPFRPPXXX